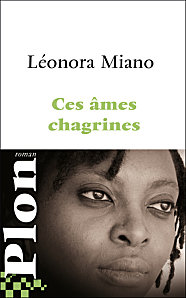Joao de Melo entre Açores et Afrique (et vice versa)
Une œuvre romanesque centrée sur deux pôles géographiques
Le premier, ce sont les Açores. Le récit intitulé "O meu mundo nao é deste reino" (1983) retrace les mœurs d’une communauté rurale de l’archipel. Le second point d’ancrage est l’Afrique, plus précisément l’Angola où l’auteur y a exercé les fonctions d’infirmier durant vingt-sept mois et ce, quand la guerre faisait rage. Cet épisode a donné naissance à "Autopsia de um mar de ruinas" (1984).
Ces deux points d’ancrage déterminent l’horizon d’écriture de l’écrivain. Ils renvoient évidemment à des moments vécus mais sur le plan de la production littéraire, leur intérêt est ailleurs. Car ni l’un ni l’autre de ces livres ne sont des témoignages stricto sensu. D’une part, nous avons affaire à des personnages fictifs dont l’identité est inventée, d’autre part, leurs actions, leur ressenti face à des situations difficiles sont aménagés en fonction d’un schéma général qui donne cohérence à ces œuvres. Si on accepte la définition d’Albert Camus selon laquelle « un roman, c’est de la philosophie mise en fiction », on peut dire que l’organisation thématique des textes de Joao de Melo obéit à une structuration rigoureuse, laquelle est absente, en général, du document-témoignage.
Une lecture même superficielle de l’"Autopsia de um mar de ruinas" (D. Quixote-1987 ; nouvelle édition revue-2017) le confirme pleinement : le principe de dualité y est constamment mis à contribution tant pour ce qui est de la répartition des manières de voir et d’agir des Africains et des soldats portugais que pour les lieux de vie de chaque groupe de combattants. Une dichotomie très profonde se maintient tout au long du récit : les Portugais vivent dans un espace fermé, la caserne. Ils ne s’en éloignent que pour affronter l’ennemi ; ils connaissent alors la rudesse de la brousse où ils pratiquent des embuscades qui donnent bien souvent occasion à des tueries de part et d’autre. Cette première division de l’espace vital des deux communautés - division parfaitement équilibrée puisque chaque part occupe onze chapitres du livre (1) est le creuset dans lequel se placent les différents personnages qui véhiculent un rapport bien déterminé aux événements.
La dualité la plus évidente touche aux racines du système colonial, à savoir la supériorité dans tous les domaines du Blanc sur l’autochtone. Cette supériorité se manifeste d’abord dans les corps constitués que sont la police et « les bureaucrates de la guerre », c’est-à-dire les membres du haut-commandement militaire de la place à Calambata dans le nord de l’Angola. Ceux-ci font preuve de brutalités en usant fréquemment du fouet. Romeu, un prisonnier angolais accusé d’espionnage, en fera les frais ; il est battu à mort alors que les preuves de sa trahison ne sont pas patentes. Auparavant, quand il échappe à ce genre de traitement, il mesure chaque jour la dureté de sa condition : « la vie du Noir, c’est pire que du fumier » juge sa compagne.
Les deux communautés se font face et chacune trouve l’occasion d’exprimer un jugement global sur l’autre. Ainsi, le Blanc juge l’Africain comme étant « fainéant » (p 153) mais ce dernier voit celui-là comme « ventru et rougeaud, escroc, méchant et vicieux » (ibid). L’Africain est conscient du lien de subordination qui le rapporte à l’homme blanc : chez les petits commerçants, eux aussi désargentés, il trouve des boissons qui lui permettent d’oublier pour un temps sa condition mais qui font de lui un être alcoolisé quasi quotidiennement et il constate tous les jours le harcèlement dont sont victimes les filles ou les femmes de la part des soldats venus de la métropole, - Natalia, compagne de Romeu, porte en elle les stigmates d’un viol commis par trois d’entre eux (p 72) et n’a pas de mots assez durs pour ceux qui « massacrent la vie et mangent les forces de tous les hommes » (p 34). Il est clair que le personnage de Nataiia est un prête-nom et que son jugement exprime en tout point celui de l’auteur ; lequel, dans une « conversation » avec Maria Graciete Besse déclare : « on croyait qu’on allait faire la guerre pour défendre la patrie. Mais la patrie, c’était la guerre, avec ses solitudes incroyables et ses violences, c’était aussi le pauvre peuple rendu esclave des Colonies, le racisme, la richesse infamante des agriculteurs et des commerçants exploitant la main d’oeuvre la moins chère du monde, ce qui ressemblait à un esclavage mitigé (…) pratiqué au nom de Dieu » (2).
Partant d’une expérience personnelle de la guerre coloniale, Joao de Melo en arrive à proposer les linéaments d’une mise en question en profondeur de l’histoire coloniale de son pays. Les sévices et humiliations infligées aux Africains, l’exercice aveugle de la force (3), les scènes où se manifeste le mépris ostensible de l’autochtone sont autant d’occurrences qui prêtent à réfléchir sur la présence des Portugais en Afrique depuis le début de l’expansion maritime qui remonte à Henri le Navigateur. Dans l’interview dont nous avons cité un extrait, on peut lire : « notre histoire nationale ne coïncide pas avec la réalité du temps présent. Le Portugal est une supercherie, une équivoque qui a engendré une grande littérature. (…) mais nous continuons à n’avoir aucune importance en Europe et dans le monde ». C’est là la conclusion ultime à partir de laquelle est entamée la critique de la politique étrangère menée dans les territoires d’outre-mer portugais. Elle constate un schisme entre la finalité du projet colonial et les modalités de l’action menée sur le terrain pour le mettre en pratique. Une telle donnée est rendue possible par la situation historique du moment soit la participation de l’écrivain à la guerre menée en Afrique par son pays. Par ce biais est dévoilé « le lien entre la critique et son propre lieu matériel » comme l’écrit Marx dans l’Idéologie allemande. Les années passées comme sergent infirmier à Calambata ont été le socle sur lequel s’est fait jour le questionnement sur l’état colonial de cette époque. Elles auront permis d’intérioriser la tactique des guérilleros qui surprennent l’ennemi en s’embusquant en des lieux dont ils savent qu’ils ne peuvent pas être repérés ou bien encore de démasquer l’action du Mouvement des Femmes venues de Luanda en période de Noël pour offrir médailles religieuses et tabac aux soldats de la métropole (p 53).
Ce temps d’Afrique aura été celui de la découverte de l’arrière-fond de l’âme humaine, - un arrière-fond de cruauté voire de férocité, témoin la scène où Aristo dit « le Terrible » joue à coups de pied avec des « têtes de nègres égorgés la veille » (p 184) ou bien les séances de flagellation d’un prisonnier angolais pour lui faire avouer l’endroit où étaient cachés armes, munitions et et combattants. De tels épisodes laisseront une trace indélébile dans le psychisme des jeunes recrues portugaises en ce qu’ ils révèlent « la part maudite » de l’individu quand il est placé dans des situations qui lui permettent d’exhumer des conduites extrêmes. Ces « blessures psychiques » (4) bouleversent la relation au moi et aux autres ; dévoilant des potentialités de comportement jusqu’alors à la fois inconnues et hors de la sphère de l’imaginable. Il en résulte une sidération généralisée de la pensée qui débouche sur un effroi d’autant plus profond que ces événements traumatiques se répètent fréquemment. Les protagonistes prennent alors des apparences fantastiques, l’hélicoptère est un grand « oiseau de secours », les balles sont des insectes meurtriers, plus généralement, tout être vivant volant est un indice de mort prochaine et de putréfaction. Les « milliers d’insectes » qui tournoient autour d’un cadavre sont autant de menaces pour la vie d’un soldat qui observe la scène. Ainsi s’opère une extension qui forme système. La métaphore animale comme procédure de représentation des sujets appartenant à une communauté humaine est fréquente sous la plume de Joao de Melo et se lit dans les oeuvres ultérieures (5).
Ces procédures stylistiques mettent à nu des vies parallèles qui, sans elles, seraient innommables tant leur côté bestial et monstrueux paraît extérieur à l’humanité de l’homme. Si ce n’était les circonstances historiques, elles rappellent les criminels les plus marquants de l’Histoire comme Gilles de Rais, le Vampire de Dusseldorf ou Jack l’Eventreur. En décrivant les atrocités commises dans ce coin d’Angola, l’auteur dévoile toute l’abjection de la lutte orchestrée par le système colonial et dévoile la dimension perverse de n’importe quel individu dès lors qu’il est plongé dans un environnement déshumanisé à l’extrême où la haine de l’Autre se concrétise par les actes qui dépassent toutes frontières morales. Cette littérature débouche ainsi sur l’étude de la perversité, celle-ci étant comprise comme une conduite déréglée vis-à-vis des normes sociales admises par le plus grand nombre. Toutefois, Joao de Melo s’en tient au relevé des exactions des hommes de la troupe dans leur désir de vengeance et de domination et n’aborde pas, comme le fera la psychiatrie, le chapitre des perversions sexuelles. Chez lui, la perversion n’est pas objet de description ni d’interrogation, elle est seulement notée avec les affects qu’elle fait naître chez celui qui en est le témoin mais ne constitue pas à proprement parler une ligne thématique à l’intérieur de l’oeuvre. Elle se limite à l’enregistrement d’ « une froide destruction de tout lien généalogique » (6) - la violence et la mort donnée brutalement étant la manifestation d’une rupture définitive entre l’oppresseur et l’opprimé - et ne déborde pas sur une réflexion autour d’une jouissance du mal comme on peut la lire chez Sade. L’auteur préfère entrevoir les conséquences de ces épisodes sur la psychologie, la peur constante de mourir cédant parfois le pas à un désir permanent de survivre parmi ce carnage même si ces soldats prennent conscience des conditions de vie exceptionnellement tragiques auxquelles ils sont soumis. « Nous ne serons jamais plus les mêmes » reconnaît Ricardo (p 202-203).
Voilà donc le butin cognitif de la guerre en Afrique en tant qu’expérience humaine selon l’auteur. Se pose toutefois la question de savoir ce qui a permis une telle compréhension. La réponse à cette interrogation se découvre en lisant les livres de Joao de Melo à orientation autobiographique comme "Gente feliz com lagrimas" (1988) (Gens heureux avec larmes) où sont décrites et analysées les relations tendues entre les enfants Nuno, Maria Amélia et Luis et les parents et, plus particulièrement avec le père qui n’hésite pas à les frapper lorsqu’il estime qu’ils ne font pas assez de travail. « J’ai travaillé comme un bœuf et souffert comme un cheval » dit le dernier nommé. Le séminaire sera une triste expérience en ce qu’elle prolonge le temps de l‘enfance et des rapports désastreux avec le père. Le protagoniste y connaîtra les invectives, les menaces et le martinet, instrument maudit d’une violence exercée collectivement par les pères et les enseignants et qui apparaît rétrospectivement comme l’archétype de l’Estado Novo, organisation socio-politique mise sur pied par le gouvernement salazariste dès 1926 et qui a bafoué les libertés individuelles les plus fondamentales.
Au niveau de la relation fictionnelle, on notera un continuum des procédures d’écriture ; les mêmes figures stylistiques fonctionnent aussi bien dans le rendu du comportement paternel que dans celui du personnel religieux au séminaire ou encore dans les manières de faire des autorités militaires ou des subalternes aux prises avec les combattants à Calambata. Cependant ces figures ou ces tours de rhétorique engendrent un penser individuel qui se présente comme un composite dans lequel se logent des bribes de discours, d’images de toutes sortes mémorisées plus ou moins fidèlement et qui, selon les circonstances, se fondent les unes dans les autres ou s’articulent selon des lois ou des occurrences difficilement décelables mais qui n’en sont pas moins efficients. Maria Graciete Besse souligne la multiplicité des voix qui se font jour dans cette « présence-absence de phantasmes anciens » (6 bis) ; il faut préciser que ce ne sont pas seulement des bribes de discours antérieurs au travail de réminiscence qui refont surface, il y a tout un amalgame d’images, d’attitudes humaines ou de postures animales, de représentations d’entités mi-réelles, mi-imaginaires qui doublent ces voix et qui en modifient la teneur. Pareil amalgame est évidemment une donnée personnelle mais il est tout autant construit sur la base de matériaux perçus ou/et oniriques et qui sont le siège de l’imaginaire collectif auquel se rattache ipso facto la personne qui déploie cette activité de mémoire.
On serait tenté de reconnaître ici la thèse de Borges selon laquelle toute littérature prend sa source dans « la Grande Mémoire, la mémoire générale de l’espèce » (7). Toute fiction est alors nécessairement fantastique en ce qu’elle s’appuie peu ou prou sur des éléments extraits des mythologies plus ou moins proches culturellement (8) avec ce qu’elles charrient de surnaturel, de fabuleux, de sacré, de religieux, de légendes. Le rôle de l’écrivain est alors de connecter, de ranger, de mixer ces éléments pour faire en sorte qu’ils soient porteurs de sens ; toute implication personnelle de l’auteur étant superflue, le récit développe donc une focalisation externe où l’objectivité interdit toute manifestation subjective de la part du narrateur.
Rien de tel avec Joao de Melo. Dans une interview parue dans le Jornal de Letras (20 avril 2017) il récusait le terme de « fantastique » pour qualifier son œuvre et préfère parler « d’ethno-fantastique », avançant que l’imaginaire qu’elle déploie est « profondément portugais ». Ce faisant, il renonce à un exposé purement logico-relatonnel des composantes de ce dernier et choisit de mettre en avant l’origine spatio-temporelle des croyances et des superstitions qu’il a connues durant son enfance et plus tard, au cours de ses voyages à l’intérieur de l’archipel. La perception des oiseaux, des animaux et de leur environnement géographique est donc culturellement cadrée.
On saisit alors la liaison entre la littérature comprise comme production de fictions et l’anthropologie entendue comme description des moeurs et des règles de vie d’une société. La première puise abondamment dans les matériaux accumulés, dans la seconde, ceci, au prix d’un double travail, l’un de nature mémoriel, l’autre de nature scripturale. Par exemple, la forêt açorienne inverse ses qualités lorsque l’auteur, alors jeune recrue de l’armée portugaise, entre en contact avec la forêt du nord de l Angola. Car l’imagination est sans limites et les données les plus objectives de l’environnement sont prétexte à des remembrances et des représentations mentales inouïes comme celles évoquées par l’auteur lors d’un voyage sur l’île de Corvo où il croit distinguer « des dragons verts » sur le bord du cratère qui domine ces lieux. On le voit, l’oeuvre de Joao de Melo peut se lire sous l’éclairage de la mythanalyse proposée par Gilbert Durand.
Toutes ces caractéristiques se trouvent dans le dernier roman de l’auteur intitulé "Livro de vozes e sombras" (D. Quixote – 2020 – 373 p). S’y développent une critique féroce de l’idéologie coloniale, une démystification du rôle tenu par la métropole dans l‘histoire de la civilisation européenne, les scènes d’une violence insoutenable exercée aussi bien par les Noirs que par les Portugais, les conséquences traumatiques de ce passé.
La nouveauté par rapport aux livres déjà publiés réside dans le compte-rendu des luttes entre les nationalistes açoriens et le pouvoir central de Lisbonne au lendemain du 25 avril. Car l’archipel a frôlé alors la guerre civile, les divisions entre les sympathisants du Front de Libération des Açores qui luttent pour l'indépendance des îles et ceux qui désirent le maintien de l‘ordre établi et conséquemment, la souveraineté de Lisbonne sur les affaires açoriennes étaient alors très profondes. Guets-apens, embuscades, attentats à la bombe, passages à tabac de ceux considérés comme des ennemis de classe, autant de faits de guerre qui ont marqué ces années. Selon la rumeur publique, Mariano Franco, un des chefs les plus en vue du mouvement à l’époque, en est le responsable. La jeune journaliste Claudia Lourenço est chargée par le Quotidiano, journal où elle travaille, de recueillir les souvenirs et les jugements de Mariano sur cette période de sa vie. Or il s’avère que l’homme n’a rien du « bandit », du « terroriste » de Sao Miguel, termes que le qu’en dira-t-on s’obstine à maintenir pour le désigner. L’interview sera finalement refusée par le chef de la rédaction du journal, lequel, ayant vécu ces drames sur l'archipel dont il est d’ailleurs originaire, ne retrouve pas dans cette conversation enregistrée, confirmation des agressions perpétrées par Mariano ni sa personnalité belliqueuse (p 357).
A partir d’une problématique identique aux œuvres qui l’ont précédé, ce roman ouvre des perspectives d’interprétation nouvelles en ce qu’il interroge l’autobiographie – l’interview étant une modalité formelle de ce type d’écrit. Il met en cause la véracité du genre en tant que tel. Un témoignage de première main peut-il travestir la vérité jusqu’à faire apparaître le contraire de ce qui a été ? L’intervieweur a-t-il la capacité d’inciter la personne qui se raconte à dire le vrai, auquel cas il tiendrait à la fois du confesseur et du philosophe socratique qui pratiquerait l’art de la maïeutique ? Autant de questions parmi beaucoup d’autres, ouvertes par ce "Livro de vozes e sombras", les aborder dans le cadre de ce travail serait une gageure tant la place nous manque. Ce n’est que partie remise…
ZOOM
Notes
(1) On se réfère ici à Lola Geraldes Xavier : Autopsia da guerra colonial em Angola - Revista Ecos - n° 009 - Juin 2008.
(2) Maria Graciete Besse : conversa com Joao de Melo in Joao de Melo : Entre a memoria e a perda - Companhia das Ilhas - 2019 - p 156.
(3) Des scènes similaires sont évoquées par Antonio Lobo Antunes « Si je racontais (dans son roman Le Cul de Judas - Edit Métaillé - 1997), par exemple, qu’on tuait les bébés à coups de bottes ou en jetant leur tête contre les arbres, ce serait trop horrible pour le lecteur... la cruauté était immense, de part et d’autre. Je me souviens de ces soldats katangais qui portaient des colliers faits d’oreilles humaines... » (A. Lobo Antunes Le Médecin des âmes (interview) - Le magazine littéraire. Ecrivains du Portugal - n° 385 - mars 2000 - pp 53-58.
Il semble que l’atteinte à l’intégrité physique soit une pratique commune de la part des colons et de leurs sbires. Les Belges se sont montrés particulièrement zélés dans ce domaine grâce aux agents de la « force publique » chargés du maintien de l’ordre au Congo. Ils manient la chicotte, fouet dont les lanières sont découpées dans du cuir d’hippopotame et qui lacèrent le corps très profondément ; ils organisent le rapt des enfants qu’ils mettent en cage sans leur donner à boire et manger aussi longtemps que leurs père, chargés de ramener une quantité de plus en plus importante de latex tiré des lianes de certains arbres de la forêt congolaise - la fabrication du caoutchouc générant à l’époque au début du siècle dernier ; ils sectionnent les mains des employés récalcitrants. Il existe d’ailleurs une photographie prise par Alice Harris, épouse d’un missionnaire baptiste, sur laquelle un homme est assis sur le plancher de la véranda de la salle de prières, regardant avec horreur les pieds et les mains de sa fillette que les gardes locaux avaient coupés. (pour plus de détails, on peut se reporter à la biographie de François Reynaert : Les trois vies de Roger Casement - Fayard 2021- Réédité en Livre de Poche 2022) .
(4) Louis Crocq : Traumatismes psychiques. Prise en charge psychologique des victimes - 2007- Elveser - Masson.
(5) Par exemple, dans "Gentes Feliz com Lagrimas" (Gens heureux avec des larmes) publié quatre ans après "Autpsia de um Mar de Ruinas", l’auteur décrit les rapports entre parents et enfants au sein d’une famille açorienne ; Luis, un des protagonistes, « apprend à être un loup » (p 244) armé d’une mitrailleuse, d’un couteau ou d’une grenade durant la guerre en Guinée avant de trouver un échappatoire à cette violence en émigrant au Canada.
(6) E. Roudinesco : La part obscure de nous-mêmes. Une histoire des pervers - Albin Michel - 2007 cité d’après la réédition en Livre de poche - 2011 - p 14.
(6 bis) M. Graciete Besse : Joao de Melo Entre a Memoria e a Perda op cit p 62.
(7) Saul Yurkievich : Littérature latino-américaine : traces et trajets - Gallimard - Coll Folio ₋ 1988 p 209.
(8) Selon le psychanalyste Jean-Paul Valabrega, auteur de Phantasme, mythe, corps et sens. Une théorie psychanalytique de la connaissance (Edit Payot - 1980), il y a des rapports étroits entre les phantasmes personnels et les mythes. Une présentation très succincte en est donnée dans une interview de l’auteur parue dans Le Monde du 15 février 1981. Elle été reprise dans Entretiens avec Le Monde - Editions La Découverte - Le Monde - 1984 - pp 159-166.
Pierrette et Gérard Chalendar