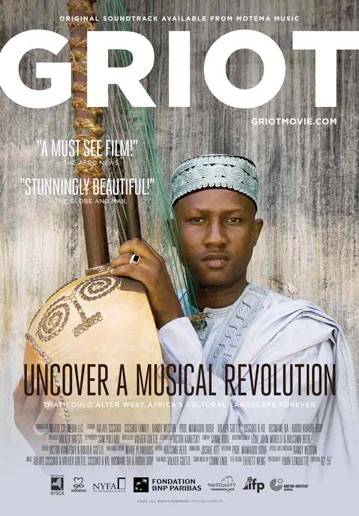RENCONTRER MON PERE, un film d’Alassane Diago
Les Films Hatari / Les Films d’ici / JHR Films
Alassane Diago part à la rencontre de son père parti à l’étranger il y a plus de vingt ans.
Aujourd’hui je suis devenu un homme, comme mon père.
Alors je décide d’aller à sa rencontre pour savoir ce qui le retient à l’étranger depuis plus de vingt ans, sans donner de nouvelles, sans revenir, sans subvenir aux besoins de ses enfants ni de sa femme.
Entretien avec Alassane Diago, réalisateur sénégalais du film Rencontrer mon père (sortie en salles le 20 février 2019).
D’où vient votre désir de cinéma ?
 Alassane Diago : Mon père a émigré au Gabon, sans donner de nouvelles et ma mère nous a élevés, seule, ma soeur et moi, sans revenus.
Alassane Diago : Mon père a émigré au Gabon, sans donner de nouvelles et ma mère nous a élevés, seule, ma soeur et moi, sans revenus.
A l’âge de neuf ans, j’ai eu la chance de rencontrer une réalisatrice française, Chantal Richard [réalisatrice de Lili et le baobab entre autres] et son amie Myriam Léotard qui travaillait à la télévision. Elles étaient en visite dans mon village. C’était la première fois que je côtoyais des blancs et j’étais très curieux d’échanger avec elles malgré mon niveau limité de la langue française.
Nous nous sommes beaucoup vus pendant leur séjour et elles se sont prises d’affection pour moi. Elles ont été sensibles à ma situation et lorsqu’elles sont reparties en France nous avons commencé à correspondre. Elles ont en quelque sorte pris la place de mon père et assumé mes frais de scolarité jusqu’à l’université. Je leur dois énormément.
L’idée de faire du cinéma est liée à Chantal. Je suis issu d’une région enclavée où il n’y presque rien ni en termes d’images, ni d’écoles, ni de transmission quelconque. Un jour Chantal Richard m’a envoyé la cassette de son court métrage, Charles Péguy au lavomatic. Nous n’avions pas de téléviseur, pas de lecteur pour visionner la cassette. Je suis allé dans un village voisin pour la voir.
J’ai grandi avec les histoires de Chantal, ses films, ce qu’ils me racontaient. Et, dès le lycée, je lui ai dit que je voulais faire du cinéma. Je me suis battu ; c’était mon rêve, je voulais le réaliser.
Bande annonce : Rencontrer mon père from JHR Films on Vimeo.
Quel chemin avez-vous emprunté pour réaliser ce rêve ?
Alassane Diago : Chantal m’a encouragé à faire un DEUG de philosophie. Puis j’ai découvert qu’une école privée qui dispensait une initiation de base aux techniques de prise de vue et de son se créait à Dakar. La formation durait quatre mois et était onéreuse mais, une fois encore Chantal et ses amis m’ont aidé à monter un dossier et à rassembler l’argent nécessaire.
A la sortie du Media Centre, je me suis rendu compte que mes acquis étaient insuffisants et que j’avais envie d’aller plus loin. Par chance, cela correspondait au moment du retour au pays de Samba Félix Ndiaye, un documentariste sénégalais qui avait fait l’IDHEC et était resté ensuite trente ans en France. Il est revenu avec la volonté de transmettre son savoir à la nouvelle génération. Je l’ai rencontré un samedi et le lundi, il m’avait installé un bureau. J’avais accès à un banc de montage, à sa bibliothèque, à sa vidéothèque. Il m’a dit “Je ne suis pas ton formateur ; je suis un père pour toi. Tu es mon fils adoptif. Il faut que notre relation soit ainsi. Je ne te donnerai pas d’argent. Si tu as envie de certaines choses, considère-moi comme ton père.”.

Avec lui, j’ai appris beaucoup de l’état du cinéma africain, mais j’ai aussi découvert Godard, Flaherty et Cocteau et j’ai eu accès à énormément de livres. Samba Félix voulait que je m’intéresse d’abord au cinéma des autres avant de me forger un cinéma. J’ai travaillé sept mois sur des tournages comme stagiaire puis assistant-réalisateur mais je commençais à m’impatienter. J’avais un projet et je voulais raconter mon histoire.
Parallèlement, j’avais envoyé mon projet à Africadoc et j’ai été admis à une résidence d’écriture. Samba Félix Ndiaye a été très surpris parce qu’il trouvait le projet médiocre et n’était pas d’accord avec le fonctionnement de ce réseau géré par des occidentaux. J’ai alors compris que mon film dont le projet me hantait n’existerait pas sous son égide et je suis parti. J’ai choisi l’aventure d’Africadoc qui constituait une véritable opportunité pour moi.
En réalité, ma formation et mon parcours sont jonchés de rencontres déterminantes à des instants-clés, avec Chantal Richard bien sûr, Samba Félix Ndiaye, les intervenants d’Africadoc, Philippe Bouychou qui a produit mes premiers films Les larmes de l’émigration et La Vie n’est pas immobile.
Rencontrer mon père aussi est né d’une rencontre. Avec Richard Copans, aux côtés duquel je me suis retrouvé au jury des Escales Documentaires de La Rochelle. Nous partagions les mêmes valeurs de cinéma, les mêmes conceptions du documentaire dans nos discussions et à la fin du séjour, il m’a dit qu’il souhaitait voir mes films. Arrivé à Dakar, je lui ai envoyé Les Larmes de l’émigration et La vie n’est pas immobile. Il m’a appelé immédiatement après les avoir vus, je lui ai fait parvenir le projet et il m’a proposé de le produire.
Richard est très respectueux du travail des autres et dès le début, il n’a cessé de me valoriser, de me donner confiance en moi-même. J’étais resté longtemps sans tourner et je songeais à me réorienter. Richard est apparu au bon moment pour me pousser à poursuivre le cinéma, me convaincre que je pouvais aller encore plus loin. Il m’a rendu un immense service.
C’était le projet de votre premier long, Les Larmes de l’émigration que vous aviez présenté à Africadoc ?
Alassane Diago : Oui, j’ai développé Les Larmes de l’émigration à la résidence mais il fallait aller au-delà. Alors je suis retourné au village m’entretenir avec ma mère que je n’avais pas vue depuis deux ans et la filmer. L’expérience était douloureuse pour elle qui n’était pas habituée à la présence d’une caméra. Elle la fuyait. Elle est extrêmement pudique et timide de nature et c’est impensable dans sa société à elle, qu’un fils remette en question les choix de son père. Ça ne se fait pas. Je touchais à des choses très intimes.
Mais elle a compris que ce travail était essentiel pour moi. Face à mon insistance, elle a surmonté ses appréhensions, m’a fait cadeau de sa confiance et de sa parole et a réussi à partager cette histoire-là. Ce qui ne devait être qu’un essai est finalement devenu le film.
Dès lors le cinéma est devenu une arme pour raconter ?
Alassane Diago : Oui, j’ai toujours beaucoup raconté, en écrivant d’abord, tout petit déjà. Cela me passionnait de relater mon quotidien et ceux de mes proches, la vie au village et bien sûr de parler de l’absence. L’absence de ce papa qui est parti m’a hanté pendant toute mon enfance. Ça été une source d’inspiration pour tout ce que j’ai fait et tout ce que je continue de faire.
Dès le début, je n’étais attiré que par le documentaire. Samba Félix Ndiaye m’avait appris qu’il n’y avait pas de grandes différences entre les deux genres. Si je devais faire de la fiction, cela ne pourrait être qu’avec des personnages réels, des décors réels, une fiction qui prend sa source et se nourrit du réel.
L’émigration est la première chose dont je voulais parler après ma formation audiovisuelle. Et ce sujet général derrière lequel je me réfugiais, cachait mon histoire. J’ai mis du temps à le comprendre ! Quand j’ai décidé de dévoiler mon histoire, j’ai compris qu’elle n’appartenait pas qu’à moi. Qu’évoquer l’émigration à travers mon prisme, ce serait finalement parler de l’émigration de façon universelle. Que les méfaits de l’émigration est un sujet qui dépasse de loin
le Sénégal, la Mauritanie, le Mali. D’où l’idée, d’aller plus loin avec Rencontrer mon père.
Dans quel contexte votre père a-t-il émigré ?
Alassane Diago : Mon village est constitué d’une population nomade, les Peuls qui vivent, depuis des générations, de l’agriculture et de l’élevage. A un moment donné dans les années 70-80, une sécheresse a, entre autres, décimé le bétail et poussé les hommes à partir pour subvenir aux besoins de leurs familles.
Mon père faisait partie de cette génération. Cette émigration massive, on a tendance à l’oublier; on en parle peu. C’est une émigration subrégionale, au sein de l’Afrique. Vers l’Afrique Centrale, le Zaïre, le Congo, le Gabon connus pour leurs mines d’or et de diamants. Aujourd’hui, les plus riches de ma région du Fouta, Nord-Est du Sénégal, ce sont ceux qui ont émigré dans ces pays-là.

Mais parmi ces émigrés très peu réussissent à faire fortune et quand ils n’y parviennent pas, ils préfèrent mourir que de rentrer. Un émigré, qui part, porte les espoirs d’une grande famille, de quarante à cinquante personnes. Et quand il échoue, le sentiment de honte le ronge. C’est une question d’orgueil. Le retour d’un émigré qui a échoué est très mal perçu par la société. Je me suis longtemps dit que si mon père n’était pas rentré, c’est parce qu’il avait connu l’échec.
Son idée de départ était extrêmement noble ; il partait chercher fortune pour subvenir aux besoins des siens. Son départ initialement n’était pas du tout un abandon; c’est avec le temps que son absence s’est transformée en abandon. Et, au pays, les familles continuent de vivre dans l’espoir de retrouver leur mari, leur fils.
C’est une émigration qui est très dévastatrice parce qu’elle sépare très longuement, parfois pour toujours, des familles. Les seuls souvenirs que j’avais de mon père, c’était ses photos que ma mère avait gardées précieusement dans sa malle. Je n’avais pas d’autres souvenirs de lui. Nous avons des rapports assez particuliers à nos pères.
Dans notre culture, l’enfant a plus d’affinités pour sa mère que pour son père. Il commence à tisser des liens avec son père seulement quand il rentre dans la lignée des adultes, avant il n’y a pas de dialogue. Moi, quand j’ai eu besoin de lui, il n’était pas là pour me transmettre les bases d’une vie d’adulte.
Quelle image aviez-vous de votre père pendant ces 20 ans d’absence ?
Alassane Diago : Mon père m’a hanté pendant toute mon enfance. Le besoin de le voir était vital. J’attendais son retour. A l’époque, il existait une caravane composée de pères émigrés qui, chaque année, pour l’anniversaire du Prophète Mohammed, rentraient au village. Obstinément, je me rendais à la gare routière, en espérant que mon père revienne, qu’il fasse partie de la caravane. Le haut-parleur de la mosquée annonçait l’heure de l’arrivée pour le lendemain, et avec ma soeur, on attendait impatiemment ce moment-là en se disant que dans 24 heures on verrait notre papa.
Pour ceux qui avaient la chance de voir leur père, c’était une magnifique surprise, c’était magique. Je n’ai jamais vécu ce moment-là. Chaque année, je nourrissais l’espoir de le voir et à chaque fois, je repartais bredouille, dépité.
Ma mère nous disait qu’il allait revenir et nous y croyions. Je lui trouvais à chaque fois des excuses et je ne doutais pas que l’année suivante, il serait là.
Quand je suis parti à Dakar poursuivre mes études, au sortir de l’adolescence, j’ai compris qu’il ne reviendrait pas. Auparavant, c’était un héros invisible, rêvé, qui ne pouvait que revenir. Ceux qui l’avaient connu parlaient en grand bien de lui, j’avais donc une envie très très forte de le connaître vraiment, de le voir enfin.

Je ne l’ai compris que récemment mais je pense que déjà en faisant Les Larmes de l’émigration, inconsciemment, c’était la rencontre avec mon père qui m’intéressait et m’obsédait. Et cette rencontre, c’est le cinéma qui l’a permis. Si le cinéma n’était pas venu à moi, je serais resté comme des milliers d’enfants dans l’attente de mon père. C’est grâce au cinéma que j’ai pu prendre l’initiative d’aller le voir au Gabon. Les Larmes de l’émigration, c’était un appel lancé dans le temps et l’espace qui était fait pour générer des nouvelles, bonnes ou mauvaises.
Comment le contact s’est renoué ?
Alassane Diago : La vie n’est pas immobile a été diffusé à la télévision gabonaise. Mon père était dans son salon avec un ami originaire de notre région en train de regarder un match et, en zappant, ils tombent sur une scène de conseil du village, dans laquelle j’interviens et prends l’exemple de son émigration. Il a très vite reconnu les gens du village, ceux de sa génération et ses aînés. Mais il s’est tu, n’a rien dit. Son ami lui a fait remarquer que les gens à l’écran ressemblaient à ceux de son village et il a nié.
Mais il n’était pas le seul à avoir vu le documentaire ! Des proches de notre région l’ont appelé pour lui dire qu’ils avaient vu un film dont l’histoire ressemblait beaucoup à la sienne. Là, il a compris qu’énormément de gens avaient vu le film. Mon père n’a jamais coupé le cordon avec la communauté sénégalaise au Gabon. Il savait toujours où prendre des nouvelles, où l’on se trouvait, si on était en bonne santé, qui était mort ou en vie au village.
Après la diffusion du film, il s’est procuré un numéro auquel joindre ma mère. Quand il l’a eue au bout du fil, après vingt ans de silence, la seule chose qu’il lui a dite c’est “Pourquoi ce film ? Tout le monde l’a vu et dans ce film, on m’humilie”. Le film l’avait profondément blessé. Ma mère lui a dit qu’elle avait fait ce film pour moi et que s’il voulait s’en plaindre, il fallait m’appeler directement. Ce qu’il a fait dans la foulée. Nous avons parlé pendant trois heures. Il n’était pas chaleureux du tout. Il en revenait toujours à l’humiliation qu’il ressentait.
J’essayais, pour ma part, de lui expliquer le bien fondé de ma démarche. J’ai fini par lui demander s’il l’avait vu en entier. Il m’a dit que non et je lui ai répondu que, si ça avait été le cas, il aurait compris que le film était plein d’amour pour lui. Il m’a réprimandé : il lui était inconcevable que je parle de lui ainsi. Je lui ai demandé pardon et il m’a répliqué qu’il n’était pas sûr de pouvoir me pardonner. Je lui ai expliqué qu’à travers ce documentaire je cherchais des réponses. Ma mère m’avait donné sa version de l’histoire et j’avais envie qu’il me donne la sienne. Je lui ai proposé de venir au Gabon avec ma caméra pour recueillir sa part de vérité. Il s’est moqué de moi, persuadé que c’était infaisable. Et à partir de là, nous sommes restés en contact.
Pourquoi lui avoir demandé pardon ?
Alassane Diago : Oui, ça peut sembler paradoxal. Mais cela découle des valeurs qu’on nous a inculquées. Si ton père est en colère contre toi et, même si tu as raison, il faut lui demander pardon. C’est primordial. Même si on t’a fait mal, tu commences par demander pardon. Pour tempérer les choses et rebondir, il fallait de la douceur. C’était un pari. Il a accepté les retrouvailles et le tournage mais il ignorait que cela allait prendre cette ampleur. Il a accepté par orgueil et fierté et parce qu’il voulait se racheter, pas à mes yeux, mais pour dire à son entourage et au monde entier qu’il n’est pas un mauvais père, qu’il n’avait pas eu le choix.
Les Larmes de l’émigration avait fait polémique dans l’entourage de mon père. On m’en a beaucoup voulu d’avoir parlé ainsi de lui, d’avoir dévoilé sa vie de cette manière.
Dans Rencontrer mon père, c’est lui qui parle, c’est différent. Je le trouve très libre dans sa tête. Il aurait pu décider d’arrêter à tout moment, refuser d’aborder certains points, exercer son autorité de père. S’il est resté, c’est qu’il voulait justifier son absence à sa manière, dire que c’est Dieu qui l’avait mis dans cette situation et qu’il n’avait pas de ressources pour revenir. Des arguments qui m’étaient incompréhensibles, que je ne pouvais pas entendre.
Et du début du tournage à la fin, j’ai refusé ces explications. C’est ce qui d’ailleurs m’a ouvert à l’univers de mes soeurs. Comme je ne parvenais pas à obtenir gain de cause avec lui, il fallait trouver une équation qui soit positive. Par mes soeurs, j’ai appris pas mal de choses qui m’ont beaucoup éclairé.
Quel dispositif avez-vous mis en place pour les entretiens ?
Alassane Diago : Pendant tout le tournage, j’étais seul à la caméra et au son. C’était impossible autrement, compte tenu du projet. Il ne pouvait pas y a voir d’inconnus entre mon père et moi. On est trois, mon père, la caméra et moi. On ne se connaît pas et la caméra, par sa présence, forçait la parole, amenait au dialogue.
J’ai conscience que la caméra est une arme. Quand j’interroge mon père sur des sujets graves, je me réfugie derrière elle pour oublier ma position de fils. Ma caméra, elle, est intransigeante, elle ne lâche rien quand moi, je peux faiblir. C’est un guide et un compagnon.
Je suis un fils qui parle à son père mais aussi un réalisateur qui filme son propre père. C’est cela qui a été le plus difficile. Trouver un équilibre entre la position de réalisateur et celle de fils. Cela se sent dans plusieurs séquences, notamment lorsque l’on parle de son bétail et où je fais la comparaison avec nous, ses enfants, ma mère. Je suis dans une quête perpétuelle de réponses, d’explications. On se cherche l’un l’autre, quand il ne parle plus, se mure dans le silence, je perds parfois mes armes. J’ignore totalement ce qui va se passer la minute d’après…
Lui se réfugie en tripotant ses téléphones portables ou en égrenant son chapelet et moi, je suis là, je ne dis rien, j’attends qu’il s’exprime et parfois cela prend du temps. Donc le temps s’installe, il est déterminant. J’ai attendu vingt ans pour lui poser des questions : j’ai le temps, ma caméra a le temps. C’est ce qui justifie ces longs plans-séquences. Je me réfugie en eux pour que rien ne m’échappe.
J’ai envie de tout capter. Je me mets à la place d’un pêcheur qui jette ses filets et attend d’attraper son poisson. C’est le même dispositif. J’étais impressionné par sa pugnacité, sa résistance. Il est comme moi. Il ne bouge pas. Ses silences sont très expressifs. Jusqu’à ce qu’il parvienne à trouver quelques mots libérateurs.
Il m’est arrivé de perdre le contrôle en filmant ce visage qui ressemblait tant au mien. C’est mon père, c’est mon histoire et parfois, dans le viseur, c’est moi que je voyais aussi. On ne me voit pas, mais derrière la caméra, il y a des moments
où je suis comme lui.
Comment avez-vous introduit la caméra dans vos retrouvailles ?
Alassane Diago : Quand je suis arrivé au Gabon pour le rencontrer après ces longues années, cela a été difficile de trouver le moment idéal pour démarrer le tournage. Je suis resté sur place six semaines. J’ai passé les dix premiers jours à l’observer sans sortir ma caméra. Je voulais mieux le connaître, son quotidien, ses habitudes, ses fréquentations, ses occupations, instaurer un climat de confiance. Au début, il redoutait la caméra, mes outils.
Mais quand j’ai commencé à tourner, au moment où je le suis avec son bétail, il était à l’aise et heureux d’être devant l’objectif, fier que ses voisins voient que son fils est venu au Gabon pour le filmer. Il était indispensable de rentrer dans son jeu, de le valoriser, de le respecter tel qu’il est, de ne pas parler de choses qui fâchent, les garder pour plus tard. Il fallait progresser en douceur. Partir de choses banales, laisser la place à de vraies retrouvailles pour, dans un deuxième temps, entrer dans le vif du sujet.
Et là, dès qu’on abordait l’absence, il se refermait. A partir de la discussion sur le cinéma, il a compris que les choses n’allaient pas être aussi simples que la séquence avec ses chèvres ! Dès lors, à chaque fois qu’il voyait la caméra, il se préparait, réfléchissait, prenait le temps de trouver ses mots. Il m’a répété à maintes reprises qu’il ne me dirait pas tout, qu’il me dirait uniquement ce qu’il trouve juste. Et moi, je prenais tout mon temps pour répliquer, me servir de ces mots-là, pour faire en sorte que chaque réponse devienne une question. Le plus dur a été la séquence autour de l’Islam.
Il est resté cinq jours à fuir, à trouver un prétexte pour sortir de la maison dès qu’il me voyait approcher avec la caméra, il sentait qu’il ne pourrait pas faire l’économie de ce sujet. Après cette conversation, il s’est senti très mal. Ma belle-mère et les enfants qui étaient là ne comprenaient pas le dialecte peul que l’on utilise. Personne ne comprenait ce qui se passait et ma belle-mère m’a confié ne l’avoir jamais vu dans cet état.
J’ai compris alors que j’étais allé très loin. Je n’ai pas tout conservé au montage mais c’était une longue séquence, très douloureuse pour lui. Il se retrouvait en situation de procès, sa parole était contestée. C’est parce que je suis musulman croyant, que je me permets cette démarche. Je connais les règles derrière lesquelles il se réfugie. Il est très pieux, respecte à la lettre les cinq prières, ses enfants vont à la mosquée, et d’être ainsi mis en face de ses contradictions est dévastateur pour lui.
ZOOM
Alassane Diago, cinéaste féministe ?
Avez-vous conscience que vos films sont toujours du côté des femmes ?
Alassane Diago : Qualifier mon travail de féministe ? Pourquoi pas ! Ma mère et moi avons tissé des liens très forts, à travers l’expérience commune de cette injustice. J’ai grandi avec une mère qui attend son mari. J’ai vécu son manque au quotidien, je l’ai expérimenté moi aussi. Son manque à elle, c’est mon manque à moi. J’en ai souffert aussi. Elle s’est sacrifiée par amour, c’est ce qui est beau chez elle. Elle a tout accepté par amour.
L’islam l’autorisait à refaire sa vie. Mais à quel prix dans son village aux valeurs archaïques ? Si tu trouves le bonheur, tant mieux pour toi. Si ça n’est pas le cas, tu es condamnée à vivre ainsi et ta seule chance alors, c’est ta descendance. Un fils, dans ma société, c’est un investissement, c’est quelqu’un qui est appelé à assurer l’avenir de ses parents. Sa seule chance, à ma mère, c’est moi. Et plus largement ma soeur et moi, ses enfants. C’est cela qui m’a amené à prendre, dans mes films, des positions jugées transgressives par ma société, par la génération de mes parents.
Ils ne comprennent pas le sens des questions que je me pose, ils sont choqués par les tabous que je transgresse, ils ne sont pas conscients des enjeux philosophiques et humains de mes prises de position. Mais j’ai confiance en la nouvelle génération. Les jeunes aujourd’hui sont presque tous scolarisés, eux comprennent très bien ce que je fais.
Matthias Turcaud