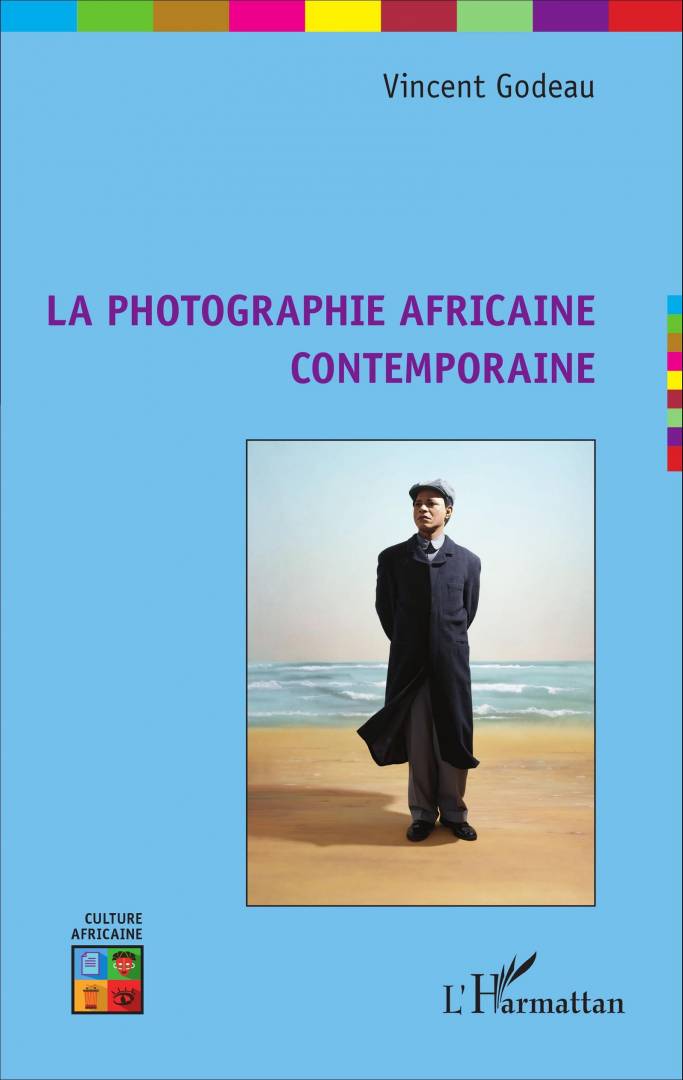
Rencontre avec Vincent Godeau autour du festival de photo de Bamako
L'Harmattan
Photographe et grand amateur de photo, Vincent Godeau a écrit un livre publié à L’Harmattan en 2016, dédié à La photographie africaine contemporaine.
A l’occasion de la 11ème Biennale de Bamako, Vincent Godeau a bien voulu répondre à quelques questions…
Quelle est votre expérience du festival de Bamako ?
Vincent Godeau : Bamako est d’abord pour moi une expérience hédoniste.
Le Musée National du Mali est agréable. Les oeuvres présentées en extérieur proposent souvent de grands tirages de qualité. La délicieuse promenade entre les panneaux où sont présentés tous ces travaux photographiques autorise une attention plus soutenue, une meilleure compréhension, un plaisir plus grand.
C’est une détente qui repose de l’affluence à l’intérieur du bâtiment principal. Où sont souvent casés beaucoup de photographies, peut-être trop.

Malick Sidibé - Nuit de Noël (Happy Club), 1963 - © Malick Sidibé
Courtesy galerie MAGNIN-A, Paris
Quels artistes exposés à Bamako vous ont-ils marqué ?
Vincent Godeau : J’ai aussi vu Bamako à travers les différents ouvrages qui lui sont consacrés. Ces manifestations ont toujours besoin de pionniers, comme de totems ou de porte-paroles. On pense d’abord à Seydou Keita ou Malick Sidibé et ensuite à la photographie malienne en général.
Grâce à André Magnin, grand dénicheur de photographes africains, j’ai pu aussi découvrir le Congolais Kiripi Katembo, le Nigérian J.D.’ Okhai Ojeikere ou le Sénégalais Omar Victor Diop. M’ont aussi beaucoup marqué le Centrafricain Samuel Fosso et le Sud-africain Guy Tillim.
Quel est le public de la Biennale ?
Vincent Godeau : Hors du milieu professionnel, les Maliens du Mali assistent peu à ces rencontres. Une des raisons connues est celle de l’Islam, réfractaire à l’image.
La presse est majoritairement celle du Nord. C’est dommage. L’un des vecteurs de l‘appropriation de la Biennale par les Maliens et l’Afrique est celui du développement de la critique et d’études sur l’image, plus diverses, plus scientifiques.
J’ai assisté récemment à Addis Abeba à un symposium photographique. Les photographes présents ont unanimement déploré la faiblesse - passagère - des discours photographiques tenus par les Africains en Afrique, ayant conscience que les discours de la diaspora ont un autre ressort.

J.D. 'Okhai Ojeikere - Oluweri Headdress, 1972 - Hairstyles - © J.D. 'Okhai Ojeikere
Courtesy Galerie MAGNIN-A, Paris.
Le regard des médias occidentaux sur la photographie africaine a-t-il changé ?
Vincent Godeau : Les journalistes viennent le plus souvent du Nord, en particulier de France. Leur adhésion à la Biennale est souvent acquise d’avance. Parfois, on estime toujours qu’il faut venir en aide aux aficionados africains de ce médium.
Et, diligentée par le Monde Afrique, Roxana Azimi affirme volontiers que la légitimité de cette Biennale est incontestable dans la mesure où les artistes présents la plébiscitent sans réserve.
Quel est le sens de l'implication française ?
Vincent Godeau : L’argent mobilisé est celui de l’Union européenne, de la France, et un petit peu celui du Mali. J’aimerais connaître les productions qui traitent de la pertinence, de l’efficacité et du devenir de ce « soft power » officiellement exercé par la France.
Beaucoup se félicitent de la capacité de la manifestation à surmonter les obstacles de l’histoire. Et se félicitent cette année des travaux « engagés » de certains photographes « activistes » (le terme sud-africain concerned photographer sonne plus juste) qui prennent à bras le corps des problèmes de société.
Bien sûr, ce terme a été vidé de sens à force d’être utilisé par des journalistes ou des commissaires d’exposition soucieux de légitimer leurs points de vue.
ZOOM
Le rapport entre photographie africaine et politique
Vincent Godeau : Un photographe non engagé est donc perçu comme un squelette de photographe. Au-delà de ça, il existe d’authentiques photographes engagés.
Le Burundais Teddy Mazina le prouve dans son travail « Des tambours sur l’oreille d’un sourd » (2008-2015). Sans complaisance conceptuelle. Et, curieusement, son travail frontal se présente, dans ses déclarations, davantage comme un travail de mémoire, et, plus fortement, une lutte contre l’amnésie. Par ailleurs, on retrouve dans sa photo de fusils à terre un motif photographique qui compte en Afrique, qui traverse son histoire.
Kok Nam, puissant et sensible photographe mozambicain, donne au cours des années 1980 une photo noir et blanc d’armes lourdes et légères, celles du Renamo et du Frelimo couchées au sol, à la fin du désarmement précédant la paix entre les deux camps.
D’une manière différente, le photographe congolais Kiripi Katembo, était à sa manière pleinement impliqué dans son travail. Disparu très jeune, il allait dans son pays au devant de son public, pour lui montrer, lui expliquer, pour l’inclure dans sa démarche avec une fougue et une clarté de vue exemplaires.
Matthias Turcaud


